 Cet article fait suite à deux essais sur les politiques de jeunesse en Tunisie (1) et au Maroc (2), édités par la Commission européenne en 2009. Le grand malaise et les tensions qui traversaient la jeunesse de ces pays à cette époque avaient été largement évoqués et on parlait déjà d’une jeunesse hésitant entre « rébellion et soumission », formule prémonitoire au regard des événements de 2010 et 2011. Il s’agit ici de définir aujourd’hui, un an après, la place des jeunes dans les États du sud de la Méditerranée, leur place dans les sociétés, en termes de force sociale et politique. Il nous faut aussi insister sur les termes de « société civile» et de « transition démocratique », car nous effectuons trop souvent une transposition hâtive de concepts et d’analyse émanant des États du nord de la Méditerranée et, pour faire court, de l’Occident composé d’États démocratiques qui ont des traditions parlementaires et pluralistes bien différentes des rivages sud et est de la Méditerranée. L’ensemble géographique de l’espace méditerranéen est traversé par des tensions et souvent des incompréhensions entre les sociétés des rives nord et sud, si bien que les évènements qui continuent aujourd’hui de bouleverser l’ordre établi des États arabes sont lus et analysés dans les États du nord à partir de grilles de lecture souvent éloignées des réalités. Il nous semble nécessaire, dans cet article, de revisiter tous ces concepts et d’approcher la complexité de cette jeunesse qui a occupé et qui occupe encore des postes avancés lors des manifestations puis des révoltes, qui surfe sur les réseaux sociaux et qui « met le levain dans la pâte sans en recueillir toujours le pain ».
Cet article fait suite à deux essais sur les politiques de jeunesse en Tunisie (1) et au Maroc (2), édités par la Commission européenne en 2009. Le grand malaise et les tensions qui traversaient la jeunesse de ces pays à cette époque avaient été largement évoqués et on parlait déjà d’une jeunesse hésitant entre « rébellion et soumission », formule prémonitoire au regard des événements de 2010 et 2011. Il s’agit ici de définir aujourd’hui, un an après, la place des jeunes dans les États du sud de la Méditerranée, leur place dans les sociétés, en termes de force sociale et politique. Il nous faut aussi insister sur les termes de « société civile» et de « transition démocratique », car nous effectuons trop souvent une transposition hâtive de concepts et d’analyse émanant des États du nord de la Méditerranée et, pour faire court, de l’Occident composé d’États démocratiques qui ont des traditions parlementaires et pluralistes bien différentes des rivages sud et est de la Méditerranée. L’ensemble géographique de l’espace méditerranéen est traversé par des tensions et souvent des incompréhensions entre les sociétés des rives nord et sud, si bien que les évènements qui continuent aujourd’hui de bouleverser l’ordre établi des États arabes sont lus et analysés dans les États du nord à partir de grilles de lecture souvent éloignées des réalités. Il nous semble nécessaire, dans cet article, de revisiter tous ces concepts et d’approcher la complexité de cette jeunesse qui a occupé et qui occupe encore des postes avancés lors des manifestations puis des révoltes, qui surfe sur les réseaux sociaux et qui « met le levain dans la pâte sans en recueillir toujours le pain ».
Un enchevêtrement de faits.
Le 17 décembre 2010, le jeune Mohamed Bouazizi s’immole par le feu dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie après la confiscation par la police de sa charrette de légumes. Moins d’un mois plus tard, le 14 janvier 2011, Zine el-Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis le 7 novembre 1987, fuit son pays, chassé aux cris de « dégage ! » scandés par la foule des semaines durant. À peine un mois plus tard, le 11 février, c’est au tour du raïs égyptien, Mohammed Hosni Moubarak, de partir, poussé dehors par une mobilisation populaire sans précédent. À la même époque, le Yémen, la Jordanie, le Bahreïn, la Libye, la Syrie, tous ces États sont agités par la même fièvre révolutionnaire. En Algérie, le pouvoir tente d’étouffer les tentatives de soulèvement en achetant le calme par la distribution des pétrodollars et en renforçant la pression militaire. La monarchie marocaine, quant à elle, s’empresse de proposer une réforme anticipée de sa Constitution qui limite les prérogatives politiques du roi sans porter atteinte à ses immenses privilèges économiques. Avant la fin de l’été 2011, la Libye, avec l’intervention de forces de l’OTAN, se libère du joug de Mouammar Kadhafi après de très violents affrontements armés.
En mars de la même année, le peuple bahreïni est écrasé par les militaires soutenus par des forces des pétromonarchies affolées par le risque de contagion au sein de leurs États. Quant aux Syriens, ils continuent d’affronter, dans le sang et les larmes, la répression acharnée des troupes de Bashar al-Assad. Nous ne connaissons pas encore l’issue de ce conflit qui prend la forme d’une guerre civile, mais il est sûr que, d’ores et déjà, le régime est discrédité. Nous sommes amenés au constat suivant : en moins de dix mois, la géopolitique des pays du Maghreb, du Mashreq, du Proche-Orient et des États du Golfe est, soit bouleversée, soit altérée par des « révolutions » aussi soudaines qu’inattendues qui cassent l’image d’immobilisme des sociétés arabes, véhiculée souvent par l’Occident et qui les fait « entrer dans l’histoire ».
Des sociétés arabes en proie à « une fatigue sociale ».
Face à ce basculement historique dont nous ne connaissons ni ne maîtrisons tous les déterminants, il est bon de rappeler combien ces sociétés arabes étaient en proie à une sorte de « fatigue sociale » en raison des contextes politiques, économiques et sociétaux qui contribuaient à les « anesthésier », voire même à les paralyser. Progressivement s’était mise en place à la tête des États une sorte de « cartellisation » du pouvoir doublée d’un durcissement sécuritaire. Aucune limite dans le temps ne laissait espérer un renouvellement des dirigeants dans ce système plébiscitaire figé. Les groupes qui monopolisaient la coercition violente avaient et ont encore, dans certains d’entre eux, un rôle considérable au sein de la société. « Le phénomène de multiplication des corps armés et de police est une caractéristique commune à de nombreux États autoritaires dont le processus d’institutionnalisation demeure inachevé. Le dédoublement et parfois la démultiplication entre armée et police, forces armées et services de renseignement, armées et milices du régime, forces armées de l’État et forces armées privées, témoignent de la défiance du régime à l’égard de ses agences militaires et sécuritaires ». (Elisabeth Picard, Armée et sécurité au cœur de l’autoritarisme).
Nous rappelons encore comme les politiques occidentales antiterroristes post 11 Septembre avaient contribué au renforcement des complexes sécuritaires, renforcement qui s’était effectué aux dépens des engagements des États dans les domaines sociaux, éducatifs et de la santé. Ces sociétés étaient traversées par la peur de la répression sous toutes ses formes. C’est cette peur qui a donné aux jeunes la force de faire « bloc » et d’avancer alors que le pouvoir attendait leur retrait. La priorité sécuritaire dans ces États avait favorisé la diminution de leurs fonctions régaliennes au profit de nombreuses ONG, de confréries, d’organes de la société civile qui se substituaient à l’éclatement de la régulation politique de la société. Est-ce la concentration du pouvoir et le détournement des biens communs au profit de quelques-uns qui ont contribué au fait que cette zone géographique, y compris les États producteurs de pétrole, soit la seule zone de la planète à avoir peu progressé durant les dernières décennies, comme en témoignent les rapports du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ?
Les chiffres sont accablants : un habitant sur cinq vit avec moins de deux dollars par jour. La période actuelle se caractérise par une pauvreté absolue importante et même croissante dans plusieurs États, dont l’Égypte, où elle touche près d’un cinquième de la population, ou le Yémen, avec près de 50 % des habitants classés dans ce registre de pauvreté absolue. Le pourcentage (officiel) des chômeurs frôle les 20 %, 23 % des plus de 15 ans sont analphabètes, il y a plus de 17 % d’illettrés malgré la très forte hausse de l’alphabétisation, sans oublier le taux de mortalité des mères, la sous-représentation des femmes dans les espaces politiques (les parlements ne comptent que 8 % de femmes députées contre une moyenne mondiale de 18 %). Ajoutons, à ces constats la prise en compte d’un contexte démographique difficile pour les politiques publiques de ces États : 65 % des populations a moins de 25 ans, l’âge moyen atteint tout juste 22 ans (contre une moyenne mondiale de 28 ans), malgré une forte et rapide baisse de la fécondité des femmes au Maghreb (de six enfants par femme dans les années 1980, on est passé à un peu plus de deux aujourd’hui). Tous ces éléments modifient en profondeur les rapports intergénérationnels et l’organisation de la société. Ils nous éclairent sur la conflictualité interne qui perdure aujourd’hui à l’intérieur de ces sociétés, conflictualité largement sous-estimée par les Occidentaux mobilisés sur des impératifs sécuritaires, des angoisses autour de l’islam, des intérêts économiques et avec un regard quelque peu condescendant à leur égard. Face à ces constats, on peut affirmer, comme Václav Havel dans son essai politique « Le pouvoir des sans pouvoir », que les individus de ces sociétés, et plus particulièrement les jeunes, étaient en position de « sous-citoyens », ce qui explique que le premier mot scandé lors des manifestations ait été « dignité ».
De quelle « société civile » parlons-nous ?
Avant d’évoquer l’organisation de la société civile, il faut plutôt parler, dans un premier temps, d’une forme de dissidence dans l’affirmation de l’individu et de la volonté de maintenir, malgré tout, des liens sociaux dans la vérité et la transparence. « Comparaison n’est pas raison », certes, mais, les propos de Václav Havel dans « Le pouvoir des sans pouvoir» sur le Printemps de Prague résonnent étrangement en écho : « Il est aujourd’hui difficile de rechercher dans quel milieu, quand et par quels sentiers sinueux tel ou tel acte ou position authentique a agi et de quelle manière le virus de la vérité s’est graduellement propagé à travers les tissus de la ˝vie dans le mensonge˝ et a commencé à l’attaquer ; une chose pourtant semble manifeste : ˝la tentative de réforme politique n’a pas été la cause de l’éveil de la société, mais bien sa conséquence finale˝».
Ce sont les jeunes, forces vives des États, par opposition aux hommes politiques considérés comme des « professionnels » de la politique, qui descendent dans les rues et sur les places et qui sont l’expression du corps social par opposition au corps politique. Ces jeunes sont en attente d’une vie sociale et économique organisée selon la logique de la société civile, suivant une ligne qui trouverait sa dynamique à l’intérieur d’elle-même plutôt que dans le rôle de l’État. Václav Havel parle de « la vraie vie » par opposition au mensonge et à la corruption ambiante des régimes autoritaires. « Notre révolution est civile, ni violente, ni religieuse » avaient pour slogan les militants de la place Tahrir. C’est selon cette approche de la société civile que nous nous interrogerons sur le rôle des jeunes dans les sociétés lors du printemps arabe.
Des jeunes « pluriels », toutes victimes d’un déclassement .
Il nous faut, en premier lieu, envisager la place des jeunes dans les sociétés arabes au moment du déclenchement spontané des évènements. Il serait plus pertinent de parler plutôt de « l’absence de place » pour la jeunesse. « Nous sommes sans être ni avoir » s’exprimait une jeune étudiante tunisienne à la veille des hostilités, lors d’une interview. Ces jeunes de 15 à 24 ans forment près du quart de la population, mais ils sont aujourd’hui moins nombreux que lors des « émeutes de la faim » et de l’apogée de l’islamisme radical à la fin des années 1980. Le démographe Philippe Fargues observait, il y a 25 ans, à la suite de la transition démographique que « les 20-30 ans n’ont jamais représenté et ne représenteront sans doute plus jamais dans la population de 20 ans et plus une proportion aussi forte qu’aujourd’hui ». De fait, dans les pays arabes, l’arrivée la plus massive de jeunes sur le marché du travail fait désormais partie du passé. Il nous faut donc écarter partiellement la thématique de l’explosion démographique comme facteur du printemps arabe et nous tourner vers les éclairages sociaux et économiques.
C’est une jeunesse encore beaucoup trop nombreuse par rapport aux capacités d’absorption du marché du travail, raison pour laquelle les taux de chômage de cette tranche d’âge (les 15-24 ans) sont très importants, allant jusqu’à 30 % en Égypte ou 32 % au Maroc, avec de grandes disparités géographiques à l’intérieur des États. En décembre 2010, l’immolation par le feu du jeune Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, où les deux tiers de la population de la région sont sans emploi, c’est symptomatique du désespoir de la jeunesse de nombreux pays arabes. Que dire aussi de la situation des jeunes diplômés ? Si l’on se réfère de nouveau à la Tunisie, 60 000 diplômés de l’enseignement supérieur arrivent chaque année sur le marché du travail alors que plusieurs dizaines de milliers sont déjà inscrits à l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant (l’ANETI). Selon une étude réalisée par Carnegie Moyen-Orient, ces jeunes diplômés sont plus affectés par le chômage que la moyenne des actifs. Alors que l’absence d’emploi formel concerne 13,3 % de la population, les jeunes qualifiés représentent 21,1 % des chômeurs. En Algérie, pays qui vit de sa rente provenant des hydrocarbures, les jeunes diplômés sans emploi sont deux fois plus nombreux que dans d’autres pays ayant le même niveau de revenu par habitant.
On peut parler de désespoir de cette jeunesse diplômée qui a nourri des aspirations d’ascension sociale par l’investissement éducatif et qui partage un sentiment de déclassement par rapport aux opportunités offertes sur le marché de l’emploi national. Dans les monarchies du golfe, la jeunesse connaît aussi un déclassement dû en partie au boom immobilier des années 2000 et à la hausse du prix du logement. Il en résulte de fortes tensions intergénérationnelles entre ces jeunes « bloqués » chez leurs parents, faute d’indépendance financière jusqu’à 30 ans et plus et leurs aînés qui ne comprennent pas et supportent mal ces enfants « gâtés » qui restent à leur charge. Cette déception touche majoritairement les classes moyennes, mais les évènements qui ont suivi la mort de Mohamed Bouazizi ont permis la rencontre entre jeunes défavorisés, des villes comme des campagnes, et jeunes intellectuels déclassés majoritairement urbains. On a assisté alors dans les États arabes à l’alliance imprévisible entre les différentes composantes de cette jeunesse « plurielle » qui partageait ce sentiment de déclassement et d’exclusion. Les jeunes de Tunisie, certes, ne sont pas les jeunes du Bahreïn ni les jeunes de Syrie ou du Maroc, mais ils partagent cependant des traits communs très médiatisés sur la Rive-Nord de la Méditerranée avec un accent mis sur le traitement du rôle des jeunes femmes dans le printemps arabe.
Qui sont ces jeunes femmes impliquées dans le printemps arabe ?
Les télévisions du monde entier nous ont montré des figures contrastées et emblématiques. Ce sont ces images de jeunes femmes arborant voiles et niqabs noirs, agitant des drapeaux dans une posture conquérante lors de manifestations populaires. Ce sont aussi ces héroïnes prenant la tête de la révolte comme celle figurant dans Le Monde Magazine du 5 février 2011 qui affiche en pleine page la photo d’une jeune femme, seule devant un cordon policier, avec le commentaire suivant « BRAVOURE. Au Caire, le 26 janvier, cette jeune femme exhorte les manifestants à avancer vers un cordon de police ». Ce sont aussi ces jeunes femmes, laïques et fières de l’être, comme Nadia El Fani, témoignant sur les plateaux de télévision. Les premières représentent ce que l’Occident redoute, les secondes l’espoir d’un basculement de cette jeunesse dans les standards de la mondialisation : jeunes blogueuses, symbolisant le combat des femmes contre la dictature et le patriarcat, héroïnes de la défense des droits de l’homme dans le monde arabe. Ces deux postures, bien réelles, restent cependant dans des représentations stéréotypées de l’engagement politique des jeunes femmes dans cette région. Il faut éviter la lecture très réductrice, dans le premier cas, d’un engagement politique féminin, prolongement et ou réaction à la domination masculine et, dans le second, faisant de la jeune femme arabe la seule véritable actrice du printemps arabe et cantonnant les hommes dans le rôle de suiveurs.
Aux yeux de l’Occident, elle ne peut être que soumise ou rebelle, posture largement reprise des représentations des jeunes maghrébines en France, rappelons-nous du mouvement « ni putes ni soumises ». En fait, l’engagement politique des femmes dans cette région n’a pas attendu le printemps arabe et il résulte souvent de causes moins héroïques mais, aussi plus profondes, comme la généralisation de la scolarisation des filles, la baisse du taux de fécondité et l’intégration progressive d’une partie de ces jeunes sur le marché du travail salarié. Une minorité grandissante a pris des responsabilités dans le monde associatif ou des engagements politiques par des mandats électifs et des postes importants dans des partis. L’étonnement des Occidentaux face à cette forte présence féminine lors des mouvements protestataires en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en Syrie, au Yémen, au Bahreïn résulte surtout de l’ignorance du phénomène de politisation progressif des jeunes femmes arabes et de leur place dans l’espace public aujourd’hui, ignorance doublée d’une certaine complaisance de leurs homologues journalistes occidentales.
« On n’imagine guère, en France, rappelle Sonia Dayan-Herzbrun, que dès le début de ce XXe siècle, il ait pu exister un féminisme militant dans ces régions du Proche-Orient qui cherchaient à la fois à se libérer de l’emprise d’un empire ottoman moribond et d’une colonisation européenne aux visages multiples. Dès qu’il est question des femmes de ce que l’on a pris l’habitude d’appeler le monde arabe, les préjugés et les stéréotypes orientalistes s’accumulent». Les débuts du féminisme dans le monde arabe sont plutôt le fait des hommes exprimant un certain « féminisme au masculin » comme l’exprime la sociologue tunisienne Leila Labidi. Ce sont des réformistes musulmans qui plaident pour l’émancipation des femmes dans le cadre de la charia dès les années 1930 et qui ont fortement inspiré le code du statut personnel tunisien proclamé en 1956 qui reste aujourd’hui le plus libéral et le plus égalitariste de tout le monde arabe, même si ce « féminisme d’État » ne satisfait plus pleinement les jeunes femmes qui descendent dans la rue en Tunisie depuis plus d’un an.
Aujourd’hui, la complexité de la lecture de la place de la femme dans les sociétés arabes et de son rôle politique a été renforcée par l’instrumentalisation de la question féminine sous les régimes autoritaires du Maghreb et du Mashreq, mais aussi dans les régimes conservateurs d’Arabie saoudite, du Maroc, du Koweït, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. Tous ces États ont valorisé une sorte de féminisme d’État en faveur des droits des femmes. Ils ont encouragé les ONG féminines travaillant pour la promotion des femmes dans l’espace public et développé un arsenal de mesures qui donnaient une illusion d’avancées démocratiques aux yeux de leurs soutiens occidentaux. L’exemple le plus emblématique est la proclamation de la Moudawana (le code de la famille) décrétée par Mohamed VI en février 2004, sorte de « féminisme islamique d’État » qui déclare l’émancipation des femmes au nom de la lecture libérale des textes religieux (ijtihad) sans remettre en cause le fondement patriarcal de la société. Ce féminisme d’État peut aussi être mis au service de la lutte contre les islamistes déclarés « les ennemis des femmes » alors que le Roi avait flatté quelques années avant « la fibre musulmane » des peuples. Cette instrumentalisation de la cause des femmes par les régimes autoritaires a toujours été contestée par les mouvements féministes. Aujourd’hui, les discours des féministes arabes critiquent un patriarcat non plus pensé comme la domination masculine, mais comme un patriarcat social, politique économique et sociétal qui empêche les hommes comme les femmes d’avancer dans la vie. Nous ne sommes plus vraiment dans un rapport dominant (les hommes) et dominé (les femmes), mais dans un rapport de pouvoir et d’aspiration à la liberté. Les jeunes femmes, comme leurs homologues masculins, veulent s’affranchir de la pression familiale et sociale devenue de plus en plus contraignante avec l’effritement du modèle familial traditionnel, la crise urbaine du logement et leur très grande difficulté à trouver un emploi. On parle même d’un « malthusianisme de la pauvreté » (Montenay, 2009). Cette expression résume la conflictualité générationnelle de tous ces jeunes « bloqués » chez leurs parents et soumis à un célibat prolongé.
Qu’en est-il du rapport des jeunes à l’islam dans les États arabes ?
Sur cette question, de nouveau la prudence s’impose ainsi que la prise en compte de la complexité. Nous retrouvons cette même fracture générationnelle dans l’islamisme avec l’opposition des « vieilles barbes blanches » aux « jeunes barbes noires » ainsi qu’aux jeunes imberbes. Si les directions des organisations politiques restent entre les mains d’hommes d’âge mûr, écartant les jeunes et les femmes des responsabilités partisanes, on a pu constater leur méfiance, voire leur retrait des mouvements de contestation « spontanés » qui échappaient à leur contrôle, par opposition aux jeunes de leurs mouvements qui se sont joints aux manifestations contre les régimes, plus en accord avec les slogans et les attentes de leur génération qu’avec leurs aînés.
Il est tout à fait possible de généraliser au monde arabe ces constats de Patrick Haenni à propos des querelles intergénérationnelles au sein de la confrérie des Frères musulmans : «Les revendications de la nouvelle génération sont : plus de transparence, moins d’autoritarisme, reconnaissance de la jeunesse, valorisation d’un travail en réseau, aspiration à la démocratie, refus des grands slogans. Ces six points sont tous en contradiction avec le positionnement de leur leadership. Ce que les Frères musulmans n’ont pas compris, en tout cas au départ, c’est que la mobilisation de leurs jeunes était autant une volonté de renversement du régime politique corrompu qu’une remise en cause du fonctionnement de l’institution qui les concerne. Là où ils appellent à la transparence, les Frères sont dans la culture du secret. Là où ils pensent en réseaux, leurs leaders pensent en organisation pyramidale. Là où ils pensent liberté d’action, leurs aînés pensent autorité et hiérarchie. Là où ils pensent démocratie, une partie du leadership ne met pas nécessairement le même contenu dans ce terme ». C’est ce clivage sociopolitique entre les classes d’âge qui constitue l’élément transversal de la jeunesse du printemps arabe. Dans leurs revendications, les jeunes islamistes sont proches des autres jeunes arabes. Comme eux, ils rejettent les méthodes paternalistes et autoritaires, ils dénoncent autant les dictateurs que les dirigeants de leur propre formation. C’est l’expression juvénile de « la disgrâce du chef » selon Michel Camau. Cet élément devrait jouer un rôle majeur lors des transitions post révolutionnaires.
Ces jeunes arabes, acteurs de la subversion plus que de la révolution.
Une des caractéristiques communes c’est, pour la grande majorité d’entre eux, l’utilisation de modes d’action pacifiques ou légaux, mais chargés d’un fort potentiel contestataire et d’une grande défiance à l’égard des institutions et du régime en place. L’occupation des places publiques a été un dénominateur commun à toutes les révoltes arabes, au point que ces places sont devenues un acteur politique à part entière, devenant les porte-parole du peuple à elles seules. Autre caractéristique de ces révoltes arabes, c’est le rôle joué par les réseaux sociaux. Pas seulement les réseaux sociaux de la jeunesse éduquée : « Facebook » et « Twitter », car ceux-ci dépendent du taux d’équipement des populations (inférieur à 10 % en Égypte et moindre encore pour les téléphones portables) et des usages très différenciés de ces médias. Ces nouveaux médias se sont superposés à des réseaux plus anciens qui structurent depuis longtemps les sociabilités des pays arabes, malgré les contrôles et les pressions exercés par le pouvoir en place, tels des syndicats comme l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), des universités ou des réseaux de solidarité comme la confrérie des Frères musulmans en Égypte, l’un des plus puissants réseaux de solidarité combattus par Moubarak. Une autre approche singulière des révoltes est à relier à des actes de la vie quotidienne, des engagements locaux apparemment sans finalité publique ou politique. Cet ensemble de pratiques, qualifiées « d’infra politiques », dont les jeunes des sociétés arabes étaient porteurs depuis des années, a explosé depuis un an et semble infléchir une forme de sécularisation de l’islamisme, une sorte de « post-islamisme » (Gilles Kepel).
Mark Levine a pu identifier les signes de ce « post-islamisme » en observant la musique «Heavy Metal ». Reda Zine, un chanteur marocain du genre, expliquait à Mark Levine « nous jouons du ˝Heavy Metal˝ parce que nos vies sont ˝Heavy Metal˝ », c’est-à-dire oppressantes, en lutte contre la censure, le jugement des autorités et le pouvoir des religieux. Rappelons aussi le rôle des graffs comme cet immense pochoir d’Alaa Abdel Fattah sur les murs d’un hôpital militaire égyptien agrémenté de ce slogan rageur « Vous pouvez nous tuer, mais vous ne nous gouvernerez pas » ou ce rappeur marocain, L7a9d, emprisonné pour avoir réclamé dans ses textes « ses droits tout de suite » et avoir déclaré qu’il préférait « vive le Peuple » à «vive le Roi ».
Et aujourd’hui, que reste-t-il ?
Certes, un an après, une partie de cette jeunesse a le sentiment d’avoir été peu ou pas entendue. Le besoin d’un retour à l’ordre s’est exprimé dans les urnes avec l’arrivée au pouvoir des islamistes, mais rien ne sera plus comme avant. Quelques exemples très significatifs viennent appuyer ce constat. Pour la première fois dans l’histoire des universités égyptiennes, les doyens ont été élus par le corps professoral et non plus désignés par leurs présidents comme il était de coutume.
La plus grande université sunnite d’Égypte, l’université Al-Azhar, vient d’inscrire les quatre libertés suivantes dans sa charte : liberté d’expression, liberté dans la création artistique, liberté religieuse, liberté dans la recherche. En Lybie, le Conseil national de transition (CNT) a annoncé la modification de la loi électorale qui doit régir l’élection de l’Assemblée constituante. Celle-ci prévoyait un quota de 10 % réservé aux femmes, mais, sous la pression de la société civile, il a été fixé à 50 %. Certes, la voix des jeunes a été très minorée dans les élections, certes la répression est souvent féroce, mais, désormais, rien ne sera plus comme avant et, pour reprendre la phrase de Václav Havel, grâce aux jeunes « le devenir est à nouveau ouvert».
Sylvie Floris
* Sylvie Floris est enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris.
Notes.
(1 ) www.salto-youth.net/downloads/4-17-1876/09-EuroMedJeunesse-Etude_TUNISIE_%28FR%29090708.pdf?
(2 ) www.salto-youth.net/downloads/4-17-1875/06-EuroMedJeunesse-Etude_MAROC_%28FR%29090708.pdf?
Bibliographie.
– BasBous, Antoine, «Le tsunami arabe», Paris. Fayard, 2011.
– BassaM, Tayara, «Le printemps arabe décodé:faces cachées des révoltes», Beyrouth. Al Bouraq Éditions, Collection Études, 2011.
– Bechir Ayari, Michaël, Geisser, Vincent, «Renaissances arabes», Ivry-sur-Seine. Éditions de l’atelier, 2011.
– Boussois, Sébastien, «Le Moyen-Orient à l’aube du printemps arabe. Sociétés sous tension», Strasbourg. Éditions du Signe, 2011.
– Camau Michel, «La disgrâce du chef, mobilisations populaires et crise du leadership», revue Mouvements, n° 66, été 2011.
– Haenni Patrick. « Islamistes et révolutionnaires », revue Averroès, n° 4-5, spécial « printemps arabe », 2011.
– Havel, Václav, «Essais politiques», Paris. Éditions du Seuil, 1991.
– Montenay, Yves,« Démographie et politique », pour la séance « Les dividendes de la transition démographique dans le monde arabe, cas général et exceptions. », lors du XXVI Congrès international de la population, Princeton, 2009.
– M’rad, Hatem, « Libéralisme et liberté dans le monde arabo-musulman, de l’autoritarisme à la révolution», Paris, Éditions du Cygne, Mémoires du Sud, 2011.
– Samir, Amin, «Le monde arabe dans la longue durée : le printemps arabe», Paris, Éditions le Temps des Cerises, 2011.
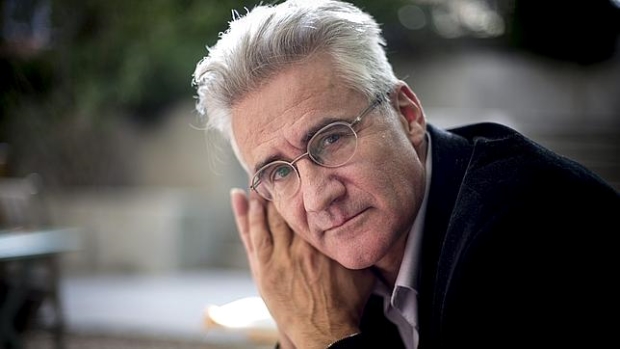 Dans mon essai « Le capitalisme est-il moral ?», paru en 2004, je montrais que la réponse, à la question qui lui servait de titre, était non. Le capitalisme n’est pas moral. D’abord parce que, pour être moral ou immoral, il faut être un individu, un sujet, une personne : un système impersonnel, comme est le capitalisme, n’est ni moral ni immoral. Ensuite parce que, même si on veut, à tort, lui appliquer ce critère de la moralité, le capitalisme, d’évidence, ne saurait y satisfaire. Le capitalisme ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement. Tout au contraire : il fonctionne à l’intérêt, personnel ou familial ; il fonctionne à l’égoïsme. Cela ne réfute pas le capitalisme, au contraire : le capitalisme fonctionne à l’égoïsme ; c’est pourquoi il fonctionne si fort (l’égoïsme est la principale force motrice).
Dans mon essai « Le capitalisme est-il moral ?», paru en 2004, je montrais que la réponse, à la question qui lui servait de titre, était non. Le capitalisme n’est pas moral. D’abord parce que, pour être moral ou immoral, il faut être un individu, un sujet, une personne : un système impersonnel, comme est le capitalisme, n’est ni moral ni immoral. Ensuite parce que, même si on veut, à tort, lui appliquer ce critère de la moralité, le capitalisme, d’évidence, ne saurait y satisfaire. Le capitalisme ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement. Tout au contraire : il fonctionne à l’intérêt, personnel ou familial ; il fonctionne à l’égoïsme. Cela ne réfute pas le capitalisme, au contraire : le capitalisme fonctionne à l’égoïsme ; c’est pourquoi il fonctionne si fort (l’égoïsme est la principale force motrice).







