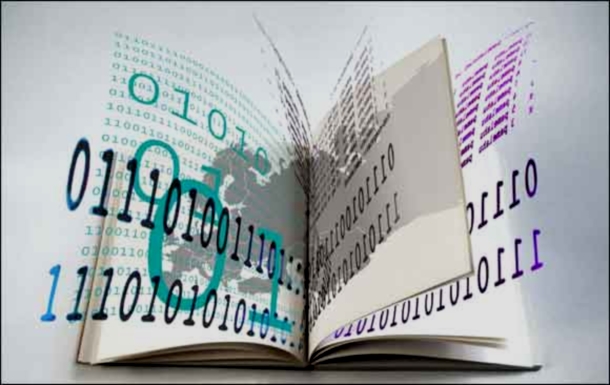L’économiste Elinor Ostrom, prix Nobel pour l’économie en 2009, est décédée le 12 juin 2012. Elle avait été la première femme à laquelle la banque de Suède avait attribué en 2009 le prix Nobel pour l’économie. Elinor Ostrom était peu connue dans le monde francophone. Professeure de sciences politiques à l’université d’Indiana aux États-Unis, elle avait mené ses recherches et ses analyses sur l’importance des biens communs. Son travail de recherche avait toujours été multidisciplinaire en combinant travail de terrain, théorie des jeux et économie expérimentale pour mieux affronter la complexité de notre temps présent. Approche multidisciplinaire que Elinor Ostrom soulignait presque toujours pendant ses séminaires avec la suivante affirmation : « there is not yet a single well-developed theory that explains all of the diverse outcomes obtained in microsettings ». Dans son essai « La gouvernance des biens communs » (éd. De Boeck, 2010), publié en français vingt ans après sa publication aux États-Unis, Elinor Ostrom affirmait que le système capitaliste occidental en poursuivant seulement le profit il était en train de détruire la pérennité des ressources communes sans contribuer à nouvelles créations. Ce carnet numérique pour rappeler les recherches d’Elinor Ostrom publie un extrait de la conversation que la chercheuse française Alice Le Roy a eue avec le prix Nobel le 14 juin 2010 à Bloomington aux États-Unis. L’entière conversation peut être lu sur le site de la chercheuse Alice Le Roy à la suivante indication numérique http://www.aliceleroy.net
Alice Le Roy. « Governing the Commons », votre livre le plus connu, a été traduit en français, vingt ans après sa publication aux États-Unis. Dans cet ouvrage, vous vous attaquez à deux théories : la « Tragédie des communs », qui postulent que chaque individu cherche à maximiser ses gains aux dépens de la pérennité d’une ressource commune, et la théorie dite du « Passager clandestin », qui démontre que dans certaines conditions les individus sont incités à profiter d’un bien commun sans contribuer à sa création.
Elinor Ostrom. Dans l’article « La Tragédie des communs », Garrett Hardin prend l’exemple d’une zone de pâturage. Selon lui, le bien commun, ouvert à tous, est promis à la ruine, chaque éleveur ayant intérêt à agrandir son troupeau puisqu’il retire intégralement le bénéfice de chaque animal supplémentaire, alors qu’il ne subit qu’une fraction des coûts collectifs. Avec cet article, ainsi qu’avec la théorie du « passager clandestin », énoncée par Mancur Olson, on a affaire à une démonstration théorique, plutôt qu’empirique. Cette théorie de l’action collective, qu’en plaisantant j’appelle théorie de l’inaction collective, prédit à son tour que les individus chercheront à profiter des efforts collectifs des autres sans y apporter de contribution. La conclusion était qu’il fallait donc soit essayer d’imposer des droits de propriété privée, soit faire appel au gouvernement pour qu’il impose une solution. Dans « Governing the Commons », je ne nie pas que le modèle hiérarchique fondé sur l’intervention gouvernementale peut fonctionner, dans certains cas, tout comme les solutions basées sur le marché. Mais ce qui importe, c’est d’analyser ces questions sans idées préconçues. Est-ce que les solutions envisagées correspondent vraiment aux conditions locales ? Le marché, le gouvernement, une communauté, peuvent être créés comme des fictions. Mais imposer une fiction sur une situation réelle ne mène en général pas à la réussite.
Alice Le Roy. Vous avez démontré qu’il était important de déterminer les limites biophysiques d’une ressource avant de déterminer un mode de gestion.
Elinor Ostrom. Oui. Il est important d’en connaître les contours. Pour les nappes phréatiques dans le sud de la Californie, nous savions où était l’océan, mais on ne savait pas grande chose d’autre. Quelle était l’histoire de l’utilisation de la ressource dans le passé ? Et comment peut-on faire pour faire reconnaître cela de manière incontestable ? Une fois que le débat contradictoire a abouti à un consensus, ça reste compliqué de parvenir à un accord. Mais au moins, cela devient possible.
Alice Le Roy. Vous avez grandi pendant la Dépression, le New Deal puis la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez déclaré avoir découvert à ce moment-là que les individus pouvaient être motivés par autre chose que la seule recherche du profit individuel.
Elinor Ostrom. J’ai découvert ça avec ma mère, avec qui je jardinais dans un Victory Garden pendant la guerre à Los Angeles (NDR : les Victory Gardens étaient des jardins potagers qui devaient permettre d’augmenter l’autosuffisance alimentaire des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale). C’était assez dur d’ailleurs, surtout quand il fallait mettre les fruits en conserve alors qu’il faisait plus de 30 degrés. Mais c’est aussi là que j’ai beaucoup appris sur la nécessité d’investir pour l’avenir.
Alice Le Roy. Vous employez des méthodes inhabituelles. En plus de mener des recherches sur le terrain, vous travaillez dans un cadre pluridisciplinaire.
Elinor Ostrom. Mon jury de thèse était composé d’un sociologue, d’un géologue, d’un économiste et d’un ingénieur hydrographe. Notre sentiment de frustration lié au manque de travail pluridisciplinaire dans le monde universitaire nous a ensuite poussé Vincent Ostrom et moi à démarrer un séminaire mêlant économie et science politique. Les travaux de recherche à l’Atelier de théorie et d’analyse des politiques publiques font aussi appel au droit, souvent à l’anthropologie, et maintenant nous travaillons de plus en plus souvent avec des géographes, des chercheurs issus d’écoles de gestion, des spécialistes de la théorie des jeux, de l’économie expérimentale, et bien d’autres.
Alice Le Roy. Pourquoi l’approche pluridisciplinaire est-elle si peu répandue ?
Elinor Ostrom. Pour beaucoup, il est plus rassurant de se cantonner à sa discipline, on publie plus aisément. Pour être nommé professeur, pour avoir une promotion, il vaut mieux que vos pairs reconnaissent votre contribution à un domaine. Cela dit, je ne conseille pas à mes étudiants de maîtriser sept ou huit approches différentes pour leur thèse. Ce que je leur dis, c’est d’utiliser des méthodes multiples, qu’ils en connaissent au moins deux très bien et qu’ils se familiarisent avec deux autres, situés à la lisière de leur discipline. Je pousse ceux des étudiants qui envisagent d’utiliser les systèmes d’information géographique (SIG) et la détection à distance de le faire avec sérieux. Ça ne s’apprend pas en quelques semaines, il faut au moins un an d’apprentissage.
Alice Le Roy. Dans vos travaux vous n’utilisiez jamais les mots « capitalisme » . Pourquoi ?
Elinor Ostrom. Eh bien parce que lorsque vous voulez diagnostiquer un problème dans le corps humain, l’utilisation d’un seul terme suffit rarement. Je pense que, de la même manière, nous devrions nous pencher plus sérieusement sur les problèmes dans le corps social. Il faut se poser beaucoup de questions avant d’avoir une bonne idée de la manière d’établir un diagnostic. La méthode diagnostique me semble d’ailleurs très importante dans le domaine des sciences sociales.
Alice Le Roy. Votre travail de recherche s’est tourné vers la connaissance, envisagée comme un bien commun. Quelles sont les principales pistes de réflexion dans ce domaine ?
Elinor Ostrom. Il reste de nombreuses énigmes. Nous savons par exemple que certains brevets protègent ceux qui font de nouvelles découvertes, mais que si on n’y prend garde, la législation sur la propriété intellectuelle peut entraîner la création d’un monopole qui exclut des usagers pendant de très nombreuses années. Dans le domaine de la connaissance, il se passe en même temps des choses très enthousiasmantes, comme le copyleft et les licences sous Creative Commons, qui permettent d’empêcher que des données ou un texte soient utilisés sans en citer la référence. Je suis très heureuse que mes travaux circulent sur le Net, et je suis également contente d’y trouver beaucoup de recherches. Cela devrait nous obliger à adopter une attitude respectueuse vis-à-vis du travail de longue haleine fourni par d’autres.
Alice Le Roy
Bibliographie électronique.
Elinor Ostrom, « La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles », Paris, Ed. De Boeck, 2010.
Elinor Ostrom, « Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action », Cambridge University Press, 1990.
Elinor Ostrom, Larry Schroeder et Susan Wynne, « Institutional Incentives and Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective », Oxford, Westview Press, 1993.
Charlotte Hess et Elinor Ostrom, « Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice», The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007.
Roy Gardner, Elinor Ostrom et James Walker « Rules, Games, and Common Pool Resources » , University of Michigan Press, 1994.
Elinor Ostrom, « Understanding Institutional Diversity », Princeton, Princeton University Press. 2005.