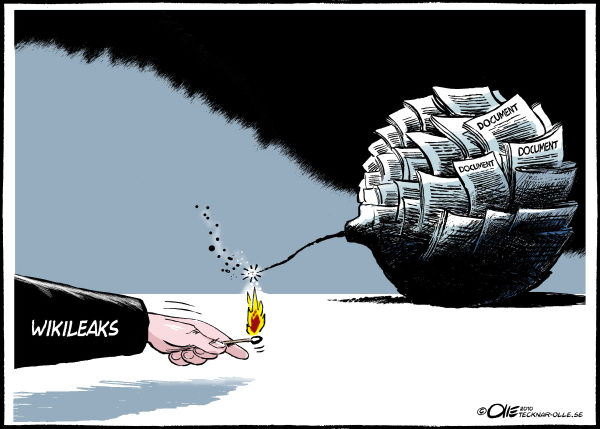Bien que le terme d’humanisme ne soit pas à la mode, j’ai décidé de l’associer au numérique pour trois raisons. Premièrement, je m’intéresse surtout à la dimension culturelle du numérique. Il existe un flou entre les mots informatique et numérique : on passe souvent de l’un à l’autre comme s’ils étaient des paroles équivalentes. L’informatique a une histoire particulière : branche des mathématiques au départ, elle s’est rapidement imposée comme une science autonome avant de devenir une industrie, puis une industrie culturelle, et enfin une culture.
Bien que le terme d’humanisme ne soit pas à la mode, j’ai décidé de l’associer au numérique pour trois raisons. Premièrement, je m’intéresse surtout à la dimension culturelle du numérique. Il existe un flou entre les mots informatique et numérique : on passe souvent de l’un à l’autre comme s’ils étaient des paroles équivalentes. L’informatique a une histoire particulière : branche des mathématiques au départ, elle s’est rapidement imposée comme une science autonome avant de devenir une industrie, puis une industrie culturelle, et enfin une culture.
Nietzsche définit la culture par le fait qu’elle modifie notre regard sur nous-mêmes, sur les objets que l’on produit et surtout sur les objets hérités. Ainsi, les effets de la numérisation sur nos rapports avec le patrimoine, les archives, les livres modifient notre regard de manière significative. En même temps, le numérique produit de nouveaux objets culturels. Le passage de l’informatique au numérique constitue donc une étape importante, un dépassement de la technicité informatique vers les pratiques et usages culturels inscrits dans le numérique. Pour reprendre l’expression de Pascal, l’informatique est l’esprit de la géométrie.
Le numérique au contraire est l’esprit de la finesse. Revenons à la définition de l’humanisme numérique. Pendant quelques années, des discours pertinents, parfois exagérés, ont insisté sur la dimension temporelle des effets de la culture numérique sur nos pratiques et usages (vitesse, flux, rapport au temps). Si notre vie quotidienne montre la véracité partielle de ces analyses, le numérique modifie de façon plus radicale encore notre rapport à la spatialité, dont on peut imaginer toutes les modulations possibles. L’être humain ne se caractérise pas seulement par le langage, mais aussi par la manière dont il façonne et habite l’espace. Or le numérique modifie – de manière importante et visible – notre habitus (la construction de la sociabilité au sens large) et les espaces que nous habitons (professionnel et privé, public et institutionnel ). Cette dimension spatiale me semble essentielle, car elle est associée à la nature hybride des objets culturels produits par la culture numérique : un va-et-vient permanent entre deux modalités, le réel et le virtuel.
Deuxièmement, il faut prendre un peu de distance avec certains discours sur les humanités numériques. On a d’abord eu tendance à imposer aux sciences humaines et sociales une forme de maîtrise des outils, d’utilisation des données et modèles quantitatifs qui accompagnent le numérique. Et réellement, celui-ci crée des traces qui ont pour effet la mesurabilité. Tout devient – ou peut sembler – mesurable (intentions, comportements…). La séduction du quantitatif fait partie des promesses de certaines approches des humanités numériques. J’encourage une réflexion sur l’histoire de nos disciplines : en quoi est-elle fragilisée par le numérique ?
Troisièmement, prenons un cadre plus large, plus pertinent et plus éloquent. Étudiant les liens entre la culture technique et les sciences humaines et sociales, Lévi-Strauss identifie, dans l’histoire de l’Occident, trois moments humanistes déterminants : l’humanisme aristocratique de la Renaissance, l’humanisme exotique du XIXe siècle (découverte des cultures de l’Orient) et l’humanisme démocratique du XXe siècle (celui de l’ethnologue).
Au-delà de l’évolution politique (de l’aristocratie à la bourgeoisie et à la démocratie), on peut observer dans ces trois mouvements une évolution de nos rapports avec le document culturel : à la Renaissance, découverte des textes de l’Antiquité classique ; au XIXe siècle, découverte de la temporalité imposée par les cultures venues d’ailleurs ; au XXe siècle, méthode de l’anthropologue et du structuraliste. Cette schématisation exprime un mouvement culturel puissant. Il me semble que le numérique est également un humanisme dans le sens où il modifie nos rapports avec les textes, les supports institutionnels édifiés au XIXe siècle (disciplines universitaires, droit d’auteur, propriété intellectuelle…) et le politique dans sa dimension démocratique (aspects collaboratifs, participatifs…). Je ne prétends pas en donner une définition précise, mais plutôt suggérer une mutation profonde que l’on peut regarder et illustrer de différentes manières.
Commençons par les effets de la mobilité. Au début, la culture numérique était une culture de la chaise : on était obligé de travailler devant son ordinateur, sans pouvoir se déplacer. Depuis quelques années, la convergence technique entre le réseau internet et le réseau cellulaire (téléphone intelligent) permet une mobilité croissante.
Comment interpréter l’émergence de cette mobilité ? Dans son texte « Les techniques du corps », Marcel Mauss observe que la manière de marcher dans la rue à Paris a été modifiée par le cinéma américain. Il en déduit qu’il existe un rapport déterminant, dans une civilisation donnée, entre la posture du corps et la nature des objets culturels produits par cette civilisation. Pour illustrer son propos, il prend deux cas extrêmes : une culture avec la chaise (la Chine) et une culture sans la chaise (l’Inde). On comprend immédiatement la nature différente des objets, qu’elle soit textuelle ou autre. Il me semble que notre civilisation est en train de vivre une mutation de cet ordre dans l’hybridisation à la fois spatiale et sociale ; c’est là que surgissent des formes de fragilité, parfois de malaise, mais aussi des promesses de nouveauté.
Cette première dimension de l’humanisme numérique touche à la fois à la position du corps et au statut de l’espace et de l’habitus. La mobilité a également pour conséquence le retour en puissance du corps à travers le numérique (le tactile, la voix…). Il faut étudier cette nouvelle configuration dans toutes ses dimensions, dans la manière dont elle modifie nos rapports avec notre héritage culturel.
En second lieu, considérons notre rapport à la mémoire, surtout collective. Avec le numérique se met en place une inversion essentielle de notre relation avec ce qui est numérisé et archivé : tandis que les interfaces numériques (comme le distributeur de billets) nous donnaient accès à des fonctionnalités bien spécifiques, le monde devient – avec l’émergence de la mobilité et de la réalité augmentée – une interface vers le numérique. Cette modification de notre rapport à la mémoire se retrouve dans la construction des archives numérisées : depuis longtemps, le patrimoine se constitue plutôt par défaut ; avec le numérique, il se construit par un tri, par un choix à la fois éthique et politique. Ce sont des questions importantes auxquelles nous devons réfléchir.
En effet, la technique ne peut pas concevoir la mémoire avec des trous, des failles ou des absences – d’où cette utopie, véhiculée par Google et d’autres, d’un accès universel. Néanmoins, les archives ont toujours été des lieux d’oubli puissants et productifs. Il faut également associer à la mémoire collective le statut des traces et de la traçabilité.
Dans l’environnement numérique, la nature même de la technique nous impose la création de traces, que les analyses algorithmiques associent à des intentions. Or le fait de visiter un site ne traduit pas forcément une intention… Le danger ne réside pas seulement dans cette confusion, mais dans une tendance à transformer peu à peu les expectations et les comportements en fonction de ces analyses. Il faut savoir contourner, résister, interpréter autrement. Il me semble que les disciplines classiques (histoire, linguistique, littérature…) ont beaucoup à nous dire à ce sujet.
Troisièmement, le statut de l’oubli – très puissant dans nos cultures – est gommé ou voilé dans la culture numérique. Je ne parle pas du droit à l’oubli de l’individu qui doit pouvoir éliminer ses traces, mais du fait que la technique ne peut pas concevoir l’oubli – si ce n’est pas comme une faille –, car c’est la nature de la machine, de la technique et du numérique. Il ne faut pourtant pas confondre les deux formes d’oubli. Notre manière d’oublier est constitutive de la manière dont nous apprenons et évoluons. Comme le dit Nietzsche, nous sommes des monstres d’oubli dans le sens où l’on deviendrait des monstres si l’on n’oubliait pas. Dans la machine algorithmique, il est presque impossible de programmer et de coder l’oubli tel que l’homme le pratique consciemment ou inconsciemment. Notre rapport avec la mémoire constitue un enjeu considérable, car il peut façonner nos rapports avec la culture.
Quatrièmement, la construction imaginaire de l’intelligence est inhérente à la culture numérique et à la technique informatique. Il y a plusieurs écoles, qui sont liées à l’intelligence artificielle, aux formes d’aide à la décision, aux reproductions de l’intelligence humaine… Pour en savoir plus, il faut s’intéresser aux discours transhumanistes sur les modifications de l’humain et du vivant par la technique. Selon la thèse de la singularité, il existe un moment où il y a convergence entre la technique et le vivant et, à partir de ce moment, c’est la technique qui dépasse l’humain dans son intelligence et ses capacités.
Du coup, il faut faire converger les deux : à la fois la transformation du vivant et de l’humain, et une période transitoire de l’humain. Cette évolution importante renvoie aux trois humanismes de Lévi-Strauss, où le Siècle des Lumières ne figure pas. Pourquoi est-il le grand absent de cette périodisation ? Avec la culture numérique, on est en train de vivre les héritages conflictuels du Siècle des Lumières. La culture du livre et de l’imprimé s’est solidifiée à la fin du XVIIIe siècle avec la mise en place juridique et économique de la figure de l’auteur, ce qui a donné lieu à toute une industrie, notamment du livre. En même temps, la tendance du bien commun – héritée du droit romain – insistait sur la libre circulation du savoir pour assurer le progrès et l’avancement des sciences. Cette contradiction entre les deux tendances existe toujours aujourd’hui.
C’est une question difficile à résoudre, car elle touche à des modèles économiques puissants et établis. On est obligé de réfléchir à un nouveau modèle intellectuel, social et économique pour essayer d’accommoder les pratiques qui mettent en difficulté l’économie classique héritée de la culture du livre et de l’imprimé. Revenons à l’imaginaire de l’intelligence, pour nous intéresser à la manière dont la science-fiction génère des modèles actifs dans la culture technique et informatique. Je propose deux illustrations de thématiques tout à fait révélatrices. La première concerne le statut de l’enfance. Une série de romans liés aux jeux vidéo racontent des histoires où des enfants prodiges sont sollicités pour jouer à de faux jeux vidéo. Dans cette projection vers l’enfance, il y a une projection de la technique sur elle-même : la technique se pense comme une enfance perpétuelle. Elle est toujours en train de s’inventer, de se renouveler et d’innover.
C’est le discours du progrès technique. Cette dimension importée de l’enfance donne un cadre intellectuel qui permet de faire avancer la production technique, surtout dans ses insertions culturelles. Deuxièmement, on constate l’impossibilité de penser un récit sur la fin de l’espèce humaine. Dans tous les discours de la science-fiction, on retrouve la thèse manichéenne d’un robot qui se cherche une identité et qui, dans cette quête, découvre son créateur et se retourne contre lui. C’est le schéma le plus classique. Or on a incorporé un récit de la genèse et de l’identité qui reproduit ces schémas familiers et ne cesse de revenir vers des histoires de généalogie. On retrouve dans cette généalogie de la technique les problèmes évoqués précédemment, c’est-à-dire la recherche des origines pour légitimer l’émergence de nouveaux repères et critères de pertinence.
Prenons par exemple la lecture industrielle, c’est-à-dire tous les moteurs ou algorithmes de recommandation et de suggestion édifiée pour nous guider vers des choix de plus en plus pertinents. Ces outils relèvent également de l’impertinence, car dans leurs suggestions, se glissent très souvent un ou deux éléments qui sortent exprès de l’expectation.
En effet, les algorithmes ont été modifiés de manière à suggérer des éléments qui surprennent l’internaute, ces éléments inattendus s’avérant souvent achetés ou consultés. L’algorithme modifie donc le paradigme même de la pertinence dans le poids de la répétition et le cumul des informations. C’est devenu un moyen de considérer la lecture sociale, c’est-à-dire une lecture partagée prenant en compte des contributions, des analyses, des annotations, des commentaires… Il y a aussi une lecture sociale dans le sens de la suggestion et de la recommandation. Le moteur de recherche Google fournit des exemples : pendant que vous tapez un mot, il vous donne à la fois des suggestions et des résultats. L’algorithme prend en compte la fréquence d’utilisation du mot en y ajoutant des éléments sémantiques.
Dans cette dimension sociale de la lecture industrielle, la sémantique donne des catégories (populaires ou savantes, héritées des bibliothèques) avec lesquelles cohabitent des moteurs algorithmiques qui se distancient de cette fonction sémantique. On assiste ainsi à un conflit entre un mouvement sur le web sémantique (porté en partie par Tim Berners-Lee ) et les plateformes (moteur de recherche de Google) qui insistent surtout sur la dimension algorithmique. Quelle dimension va l’emporter dans la détermination de la pertinence ? À mon sens, cette tension va s’accélérer et pourrait produire des effets inédits.
Ce partage entre la sociabilité – dans ce sens spécifique – et la sémantique, se manifeste également dans le retour en vigueur du cloud computing, une forme qui met l’accent sur la fragmentation de l’identité numérique dans sa nature plurielle et polyphonique. Nous avons tous plusieurs pseudo, plusieurs comptes de messagerie. La nouveauté avec le nuage, c’est que ces traces sont rassemblées du fait de la concentration des accès chez quelques fournisseurs dominants. Ces données modifient et alimentent la recommandation ou une certaine forme de lecture industrielle et sociale, transformant la nature même de l’identité dans sa déclinaison numérique.
Curieusement, avec la globalisation et l’universalisation de l’accès, il y a un retour très puissant du local. Par exemple, Google donne des résultats différents en fonction du lieu où l’internaute se trouve, et certaines plateformes permettent à des personnes géographiquement proche de dialoguer sans se connaître. La géolocalisation a ainsi créé une nouvelle forme de valorisation qui produit des effets de proximité ou de voisinage, effets qui modifient considérablement ce que l’on voit, ce que l’on obtient comme résultats et la manière dont on perçoit les interactivités et les échanges sur internet. Cela peut jouer dans les deux sens : être utile à la diversité culturelle et linguistique, ou appauvrir l’offre. Notons également que les interfaces se raréfient puisque ne restent que les miniapplications (sur les téléphones intelligents) et quelques navigateurs.
À l’époque des conflits entre Netscape et Internet Explorer, les débats associaient le choix du navigateur à la liberté de l’individu. Après une période un peu floue, le navigateur revient en force, mais de manière différente : devenu le lieu de la sociabilité, un lieu qui gère et agrège presque toutes les activités numériques, il remplace en grande partie le système d’exploitation. Au final, deux ou trois producteurs de navigateurs déterminent à eux seuls les interfaces, les manières de voir le monde numérique et d’échanger avec lui. D’ailleurs, ils dépensent beaucoup d’argent pour numériser les archives, mais très peu pour développer les interfaces qui donnent accès à ces archives. Sous couvert de neutralité, ces interfaces sont laissées à d’autres… Il faut donc penser à la fois cette concentration du pouvoir et ce dépassement du système d’exploitation classique.
Restent néanmoins les formats et les standards. Comme les données que nous produisons appartiennent à des plateformes, il nous faut des protocoles, des standards et des formats libres et ouverts pour assurer à tous un accès équitable – et c’est là que les gouvernements, tant aux États-Unis qu’en Europe, ne font pas leur travail. Il nous faut des moyens de contrôler et de faire circuler ces données publiques, qui nous sont présentées comme une promesse de ressources pour la prochaine étape d’internet. Pour appréhender la sociabilité numérique, qui a été remarquablement étudiée par Antoine Casilli et Danah Boyd, j’ai pris un point de vue un peu différent en posant une question : pourquoi a-t-on utilisé l’amitié pour construire la sociabilité numérique ?
Utilisons trois références classiques pour tenter de répondre à cette question. Aristote affirme que c’est l’amitié – non la parenté ou d’autres formes de liens – qui rend possible la genèse d’une communauté sociale et politique. Pour Cicéron, l’amitié est de l’ordre du visible. On veut partager l’intime, qui n’appartient pas à l’ordre de la visibilité et ne peut donc s’articuler que dans un discours. Par conséquent, l’amitié transforme la force intérieure en passant par le langage. Cette dimension permet de comprendre en partie ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. On observe notamment le rôle important du statut de l’image dans la sociabilité numérique. En effet, chaque profil contient un portrait par défaut, que l’internaute peut personnaliser.
Ce sont des formes d’articulation de l’intime, constitutives d’un certain échange discursif dans les relations d’amitié. Je ne confonds pas l’amitié au sens classique avec la convivialité, mais il y a des éléments partagés qu’il faut valoriser et étudier. Le chancelier Bacon, pour qui l’amitié a toujours été un calcul, fait référence à un adage classique : si vous avez un ami, vous partagez votre malheur et multipliez votre bonheur. La calculabilité associée à l’amitié numérique n’est pas bien loin… Les formes de calcul qui touchent au domaine de l’intime existent depuis longtemps.
Ce qui a changé, c’est l’échelle et la visibilité de ce partage et de ce calcul. Il faut réfléchir aux mutations induites par cette évolution, cette forme d’adaptation employée par la sociabilité numérique. En conséquence, ma thèse est très simple : le numérique opère des ruptures, mais dans la continuité. Ils sont en train de se constituer des formes d’hybridation relatives à l’espace, aux relations dans la société, à la nature de notre identité.
Finalement, on retrouve dans la sociabilité numérique – surtout sur Twitter et Facebook – les fonctions classiques de l’image, c’est-à-dire l’icône (incarnation d’une présence), le portrait (représentation d’une absence), l’emblème (image associée à un texte). Il y a une concentration des effets de la représentation visuelle, ce qui explique en partie la puissance de l’image dans le monde numérique.
Par ailleurs, deux tendances contradictoires coexistent : le monumental (il suffit de regarder les chiffres !) et la miniaturisation (Twitter, par exemple). Selon moi, on ne fait circuler que des fragments (d’images, de textes, de discours, d’identités…). J’ai appelé ce phénomène la tournure anthologique, l’anthologie étant pratiquée depuis l’Antiquité : on dispose de beaucoup de matériel nous indiquant d’une part une forme de sagesse qui a toujours été transmise dans une littérature volontairement fragmentaire, d’autre part des anthologies de fragments créées à cause de la rareté de l’accès et de l’objet. Aujourd’hui, c’est l’inverse : nous vivons dans une époque de la surabondance, mais nous pratiquons la fragmentation et la reconstruction d’anthologies qui peuvent se partager, se transmettre et signifier des choses différentes en fonction du contexte. En conséquence, les pratiques numériques ont modifié le contexte lui-même (fragmentation et sociabilité) et notre rapport avec le narratif et le récit – le fragmentaire devenant le style même de l’écriture et une forme de pensée.
Pour terminer, je voudrais revenir à notre point de départ, à la distinction qui a longtemps été faite entre la technicité de l’informatique et la dimension numérique. Comme si le Code numérique n’était qu’une suite d’instructions que la machine opère. Le Code n’est pas seulement algorithmique ou normatif. Il est aussi un être culturel agissant dans un contexte spécifique : d’ordre technique qui modifie notre rapport à l’écrit et à la culture de l’écrit. Le code n’est pas exclusivement destiné à la machine, mais aussi aux êtres humains ; c’est une forme de pratique lettrée vouée au commentaire et à l’annotation. Cette écriture, qui a ses propres propriétés, modifie notre rapport avec l’imprimé et l’écrit. Nous sommes en train de témoigner de cette culture et de la fabriquer.
Milad Doueihi
* Milad Doueihi est historien des religions, titulaire de la Chaire de recherche sur les cultures numériques à l’université Laval au Québec. Milad Doueihi a été professeur au département de français de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis entre 1985 et 1995, responsable pour la version française de la revue Modern Languages Notes en 1996 et enseignant-chercheur honoraire à la faculté des cultures et langues modernes à l’Université de Glasgow. Traduit en plusieurs langues, il s’est imposé comme l’un des grands défenseurs d’un humanisme numérique. Il a publié « Pour un humanisme numérique», Paris, édition Le Seuil, 2011; « La grande conversion numérique », Le Seuil, 2011; « Solitude de l’incomparable, Augustin et Spinoza », Le Seuil, 2009; « Le Paradis terrestre : Mythes et philosophies », Le Seuil, 2006; « Une histoire perverse du cœur humain », Le Seuil, 1996.
 Conversation avec Tzvetan Todorov, essayiste, historien. Sa carrière professionnelle s’est déroulée au CNRS du 1968 au 2005, où il est aujourd’hui directeur de recherche honoraire. Structuraliste au départ, il a beaucoup écrit sur les idéologies du XX siècle. En 2008, son œuvre a été couronnée par le prestigieux prix du Prince des Asturies. Auteur des nombreux essais dont : « L’histoire des idées : théorie du symbole», 1977 ; « Nous et les autres », 1989 ; « Le jardin imparfait », 1998 ; « Éloge de l’individu », 2000 ; « Les aventuriers de l’absolu », 2006; « La peur des barbares », 2008; « La signature humaine », 2009; « Le siècle des totalitarismes », 2010. La conversation a eu lieu à Venise auprès de l’université Cà Foscari au mois de mai 2013 et à Milan pendant le festival La Milanesiana au mois de juillet 2013.
Conversation avec Tzvetan Todorov, essayiste, historien. Sa carrière professionnelle s’est déroulée au CNRS du 1968 au 2005, où il est aujourd’hui directeur de recherche honoraire. Structuraliste au départ, il a beaucoup écrit sur les idéologies du XX siècle. En 2008, son œuvre a été couronnée par le prestigieux prix du Prince des Asturies. Auteur des nombreux essais dont : « L’histoire des idées : théorie du symbole», 1977 ; « Nous et les autres », 1989 ; « Le jardin imparfait », 1998 ; « Éloge de l’individu », 2000 ; « Les aventuriers de l’absolu », 2006; « La peur des barbares », 2008; « La signature humaine », 2009; « Le siècle des totalitarismes », 2010. La conversation a eu lieu à Venise auprès de l’université Cà Foscari au mois de mai 2013 et à Milan pendant le festival La Milanesiana au mois de juillet 2013.